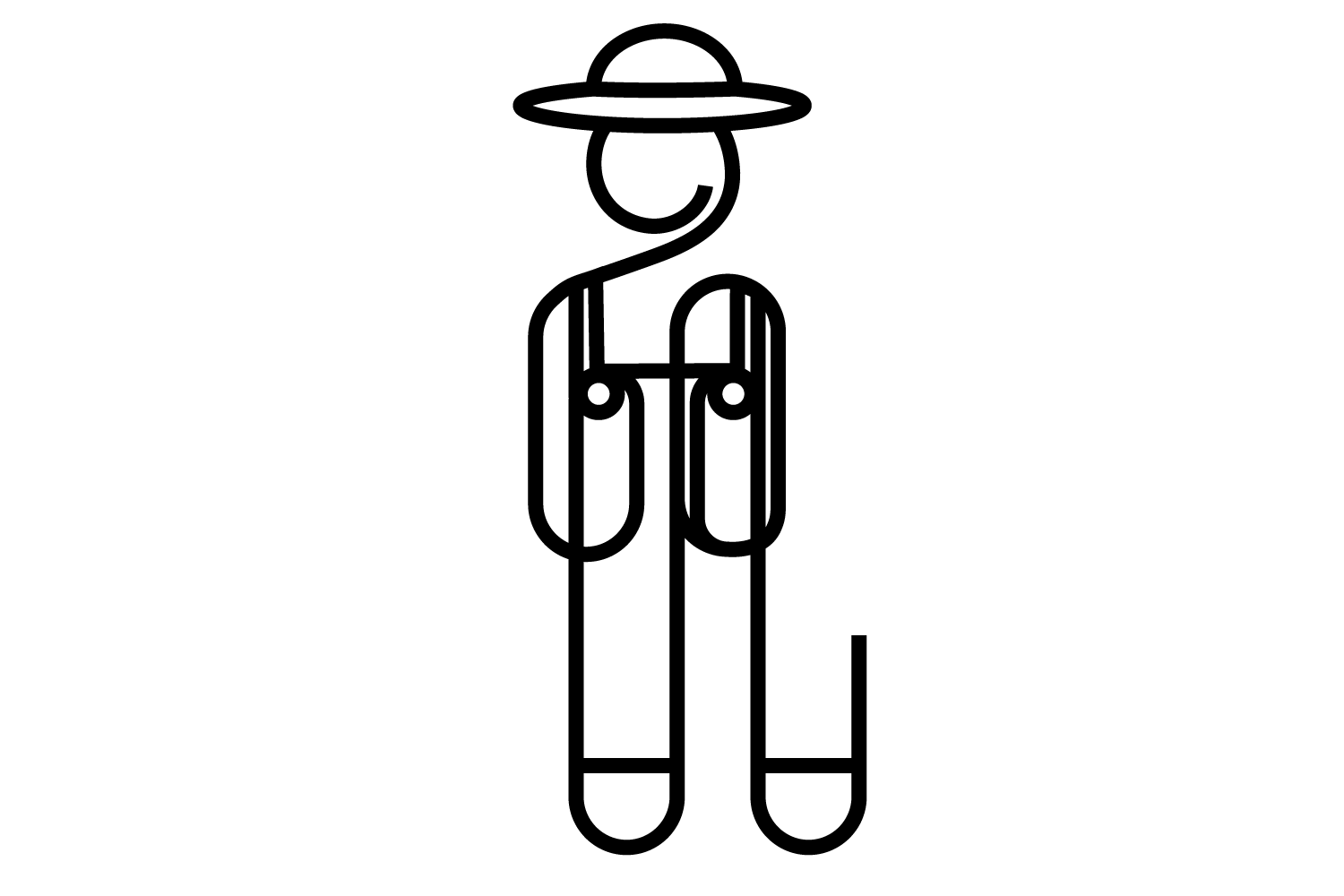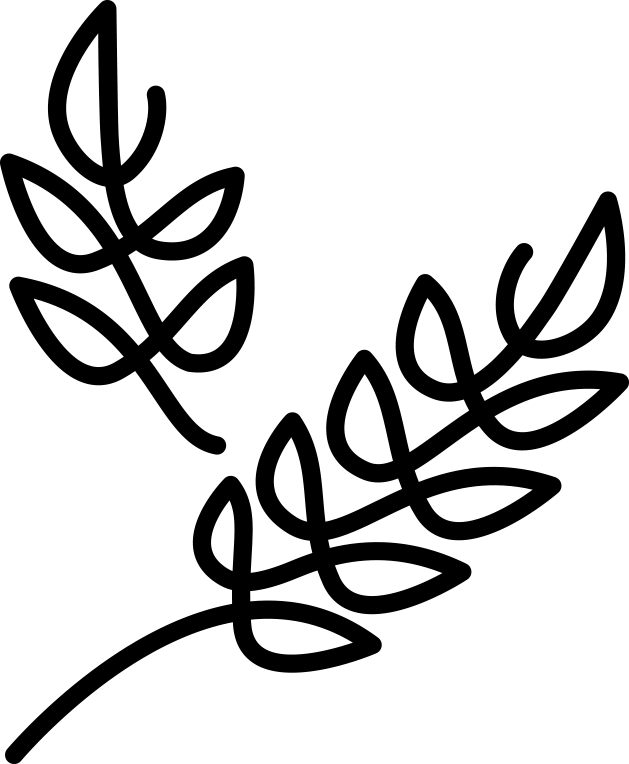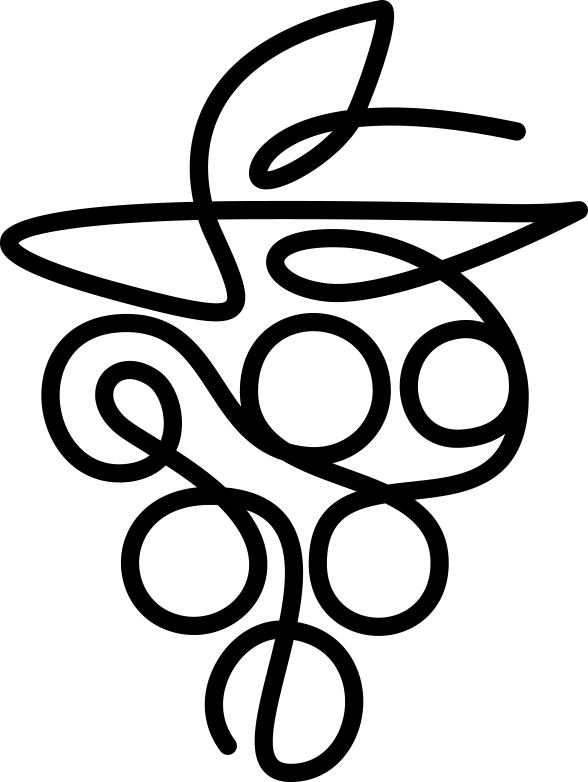Mieux transformer le maïs

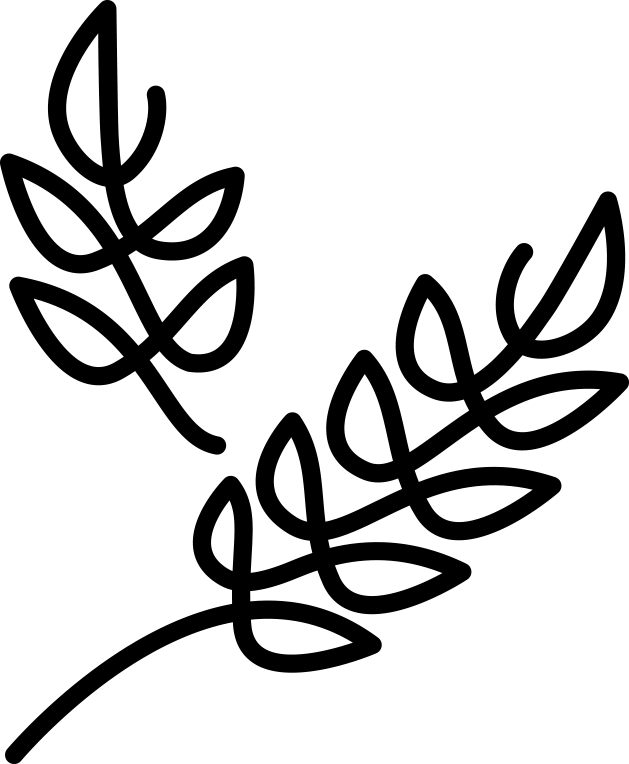
Une chaudière à rafles de maïs pour transformer proprement et moins cher
du maïs !
Remplacer le gaz par des rafles de maïs pour alimenter en vapeur d'eau une unité de transformation agroalimentaire : un défi technique et environnemental relevé par Limagrain sur son site industriel d'Ennezat, dans le Puy-de-Dôme, grâce à la proximité géographique entre production et industrie. 4 500 tonnes : c'est la masse de rafles de maïs qui sort chaque année de l'unité de production de semences du groupe Limagrain d'Ennezat, dans le Puy-de-Dôme.
2 800 tonnes de CO2, c'est l'empreinte carbone annuelle générée par le chauffage au gaz de la vapeur d'eau destinée à transformer du maïs et des pommes de terre en futurs snacks apéritifs et autres corn-flakes, sur ce même site. 950 °C ! C'est la température fatidique au-delà de laquelle les rafles de maïs, très riches en silice, se vitrifient, autrement dit se transforment en verre. Il a donc fallu du temps pour résoudre une équation compliquée destinée à utiliser les rafles de maïs pour alimenter une chaudière et ainsi économiser beaucoup de gaz. «Les premiers essais ont eu lieu dès 1987 mais se sont heurtés à des impossibilités techniques, se rappelle Damien Mercier, responsable technique chez Limagrain Céréales Ingrédients (LCI). Grâce à notre prestataire Dalkia et au fabricant de chaudières Comte, le dossier est ressorti en 2010 et une solution a été trouvée pour chauffer l'eau avec des rafles sans dépasser 950 °C.»
Après de longs mois de travaux et 2,4 millions d'euros d'investissement, la chaudière à rafles de maïs de LCI a désormais à son actif près de cinq campagnes de chauffage propre et économique de l'usine de snacks et pellets. «Les rafles fournissent aujourd'hui 89 % de nos besoins de vapeur sur le site d'Ennezat. Elles nous font économiser 2 600 tonnes de CO2 grâce au gaz que nous n'utilisons pas et 200 autres tonnes de CO2 grâce au transport dont nous n'avons pas besoin», précise Damien Mercier, qui ajoute : «Le pouvoir calorifique des rafles de maïs est plus élevé de 15 % par rapport à celui du bois et les cendres, riches en silice, sont incorporées à d'autres produits à composter.»
Côté finances, le gain est tout aussi intéressant puisque ces coproduits issus de la production de semences voisines sont gratuits pour Limagrain. La construction de la chaudière a quant à elle été en partie subventionnée (conseils général et régional, Ademe, Feder
) et un retour sur investissement est prévu au bout de sept ans. Inédit en Europe en 2013, le projet de Limagrain a depuis fait des émules et quelques autres chaudières à rafles de maïs voient désormais le jour.
D'autres solutions pour cet enjeu